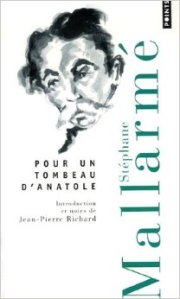Avec un certain retard, voici enfin mis en ligne l’entretien réalisé en compagnie de Jón Kalman Stefánsson et de son traducteur et interprète, Éric Boury, lors de la 29e édition de la Comédie du livre de Montpellier. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l’œuvre sublime du romancier islandais, vous trouverez une brève critique de sa trilogie romanesque ICI. Si vous voulez écouter l’entretien (je vous le conseille, l’islandais est une langue magnifique !), c’est ICI. Sinon, en voici une transcription.

Avec Jón Kalman Stefánsson et Éric Boury, Montpellier, le 24 mai 2014.
Chryseia : Jón Kalman Stefánsson, Éric Boury, bonjour. Jón Kalman, en France, vous êtes essentiellement connu pour une trilogie romanesque : Entre ciel et terre, La Tristesse des anges et Le Cœur de l’homme ; nous allons donc d’abord parler de cette œuvre, si vous le voulez bien. Tout d’abord : comment est né ce roman, d’où vous est venue l’idée première de la trilogie dans son ensemble ?
Jón Kalman Stefánsson : La manière dont tout cela a commencé, l’écriture de cette trilogie ? Au départ, je voulais écrire un livre, un seul livre, et un livre tout à fait différent de ce qu’est devenu Entre ciel et terre. Ce qui rend la littérature et l’écriture intéressantes et même fascinantes, presque magiques, c’est qu’elles ne sont pas prédictibles. On ne peut jamais prédire l’écriture. Je pense que si on réussit, quand on écrit un livre, à le préparer entièrement, à l’organiser entièrement avant même de l’écrire, c’est-à-dire à faire un plan tout à fait précis, et qu’on suit ce plan, et qu’on réussit à le mener à terme sans rien changer, alors on assassine la littérature et la poésie.
C. : À propos de poésie justement : en France, on associe presque toujours votre écriture à celle d’un poète. On parle du roman d’un poète, d’un romancier poète, etc. Est-ce que ce mélange des genres (prose poétique / prose romanesque) est commun en Islande ? Êtes-vous conscient de cette écriture très poétique ?
J.K.S. : On dit parfois que le roman nordique (ou scandinave) se caractérise par sa mélancolie. C’est à la fois vrai et, en même temps, une connerie sans nom. Mais nous avons des géants en Scandinavie, comme Steen Steensen Blicher, un écrivain danois, et Knut Hamsun, un écrivain norvégien, qui tous deux écrivent en usant de perceptions poétiques, sur un ton poétique. Je pense que le roman poétique ou à tonalité poétique n’est pas du tout peu fréquent en Islande, on en trouve. Ce n’est pas une forme de roman exceptionnelle.
Si j’écris de la manière dont j’écris, c’est tout simplement parce que c’est comme ça que je pense. C’est comme ça que je vois le monde. Mais en même temps, en tant qu’auteur, il y a autre chose : on essaye toujours de trouver de nouveaux moyens, de nouvelles techniques pour cerner et décrire le monde. Et ça, on le fait en recourant aux techniques narratives ainsi qu’aux techniques poétiques, c’est-à-dire celles initialement propres à la poésie elle-même.
C. : La poésie et puis les mots, les mots que vous choisissez. Dans vos romans, vous faites des mots des agents à la fois salvateurs – qui aident à vivre – et destructeurs – qui causent la mort. En tant qu’écrivain, comment qualifieriez-vous votre rapport aux mots ? À l’islandais en général, peut-être, et aux mots en particulier ?
J.K.S. : Les mots, c’est la seule arme qui soit à la disposition des poètes et des écrivains. La relation avec les mots est très particulière, car ils sont à la fois notre seule arme et nos ennemis principaux. En tant qu’écrivain, on doit placer toute notre confiance dans les mots et en même temps constamment les mettre en doute. Je pense qu’il est très important de toujours garder cela à l’esprit, de toujours se rappeler que les mots sont tout, mais qu’en même temps, ils sont susceptibles de vous trahir. Le langage est susceptible de vous trahir. C’est pour cela que l’on essaye toujours d’aller plus loin avec la langue, de la pousser dans ses derniers retranchements, entre autres en utilisant des procédés poétiques et narratifs.
Quant à la langue islandaise, c’est ce qui fait de nous une nation. C’est aussi simple que cela : nous sommes islandais parce que nous parlons islandais.
C. : À propos de la dimension temporelle à présent. Quand on lit vos romans, on a l’impression de partir pour un long voyage. Le temps semble dilaté. Pensez-vous que c’est nécessaire à l’épanouissement de la pensée, à son développement ? En fait, c’est très loin du monde actuel où tout est urgent, où l’on n’a pas le temps de penser. Dans vos romans, on a l’impression que les personnages peuvent développer leur réflexion.
J.K.S. : En réalité, je n’ai jamais vraiment compris les concepts que sont présent, passé et avenir. Pour moi, il n’y a qu’une forme de temporalité, c’est l’existence humaine, la vie d’un être humain. Et nous, nous oublions assez souvent, voire constamment, qu’en fait nous vivons dans plusieurs temps à la fois, dans plusieurs époques à la fois. Parce que nous avons à l’intérieur de nous, de nos consciences, d’immenses lacs, voire des océans de souvenirs. Ce qui signifie que le passé, notre passé a constamment une influence sur nous, sur ce que nous sommes ici et maintenant. Le passé ne passe jamais, il ne disparaît jamais.
C. : À propos de passé, de souvenirs et d’oubli : dans vos romans, on a l’impression que la mort est avant tout l’oubli des vivants : on meurt vraiment quand les vivants vous oublient. Quelle est votre perception de la mort en général ? Est-ce qu’il s’agit juste de cet oubli, ou est-ce autre chose ?
J.KS. : Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours beaucoup pensé à la mort. Je pense que c’est lié à ma nature d’une part, et aussi au fait que ma mère est morte quand j’étais enfant. J’ai toujours eu beaucoup de difficultés à accepter que la mort soit un phénomène qui enlève un être humain de la surface de la terre de manière définitive. En réalité, à chaque fois que j’écris, j’écris pour comprendre ce qu’est la mort, pour percevoir ce qu’il y a au-delà de la mort, pour essayer de trouver des réponses. Évidemment, ce sont des essais et une quête désespérés, mais j’essaye quand même de forcer la mort à me dire ce qu’elle est – ou plutôt ce qu’il est, car la mort est un nom masculin en islandais.
C. : Après la mort, revenons à la vie, et plus particulièrement à la nature, cette force de vie suprême. Dans vos romans, on sent bien que l’homme est lié à la nature, il fait partie d’elle. Peut-être a-t-on trop tendance à l’oublier dans le monde contemporain. Est-ce que le fait d’être islandais, d’être dans cet environnement particulier et assez rude qui est celui de l’Islande vous a rendu plus sensible à ce lien, ce partage d’existence entre l’homme et la nature ?
J.K.S. : Oui et non. L’Islande est un pays extrêmement moderne. Nous sommes très occupés par les ordinateurs, les nouveautés techniques. Nous sommes plongés dans l’informatique, Internet et compagnie. Comme dans tous les pays occidentaux riches, dont l’Islande fait partie, cette prospérité, ce bien-être et le recours massif à la technique ont eu pour effet de nous éloigner de la nature. La technique et la technologie sont des choses merveilleuses, elles permettent de rendre le monde meilleur, ou en tout cas de nous le rendre plus confortable. Ce qui est assez inquiétant en revanche, presque menaçant, c’est que nous, en tant qu’êtres de raison, nous ne parvenons plus vraiment à maîtriser l’évolution des techniques. D’une certaine manière, on n’a plus le choix. Si l’on est confronté à une nouvelle technologie, on ne peut pas dire : « Non, non, on ne fait pas cela car ce n’est pas bon pour la vie. » On est obligé de l’accepter, d’accepter l’émergence des nouvelles technologies. On le voit en Islande comme partout ailleurs. Plus le temps passe et plus nous nous éloignons de la nature, ou plutôt plus la nature est loin de nous.
C. : Est-ce pour cette raison que vous avez choisi d’écrire un roman qui se passe à l’extrême fin du XIXe siècle ? Est-ce pour revenir à un temps où la nature et l’homme étaient indéfectiblement liés ?
J.K.S. : C’est peut-être une des raisons. J’avais peut-être envie de raviver le souvenir d’une époque où l’homme était aussi lié, aussi dépendant de la nature qu’il l’est aujourd’hui de la technique. Mais l’une des raisons aussi pour lesquelles j’écris sur le passé, c’est parce que si nous oublions le passé, alors nous détruisons en même temps notre futur. Cela dit, je précise toujours que pour moi, ces romans (ceux de la trilogie) ne sont pas des romans historiques, mais simplement des romans.
C. : Une dernière question : est-ce que d’autres traductions françaises de vos œuvres sont prévues ? Car vous n’avez pas écrit que ces trois romans, mais ce sont les seuls actuellement disponibles en français. Alors, peut-on en espérer d’autres ?
J.K.S. : Avant d’écrire Entre ciel et terre, j’avais écrit six romans ; et après la parution de la trilogie, j’ai publié en Islande un roman à l’automne 2013. Mais comme mon traducteur est le meilleur traducteur du monde [il s’agit bien entendu d’Éric Boury !], il a tellement de choses à faire qu’il ne peut passer son temps à me traduire moi ; il n’y a pas que moi. Mais j’ai cru comprendre que mon dernier roman, Les poissons n’ont pas de jambes ou Les poissons n’ont pas de pieds, devrait paraître à la fin de l’année prochaine en France.
C. : Jón Kalman Stefánsson, Éric Boury, merci beaucoup !

Avec Éric Boury et Jón Kalman Stefánsson, Montpellier, le 24 mai 2014.

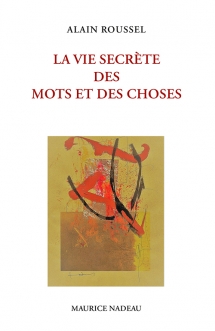







 Les plus friands céderont ensuite à la tentation et s’offriront comme moi l’exquis catalogue publié pour l’occasion. Deux essais envisageant la place de l’amour et de la sexualité chez Victor Hugo ouvrent le volume, qui donnent également un bon aperçu du contexte (social, moral, artistique). Puis vient un florilège de beautés plastiques et de découvertes textuelles (extraits de textes hugoliens publiés du vivant de l’auteur mais également de carnets, lettres, œuvres posthumes, etc.). Le plaisir physique procuré par ce livre qui flatte l’œil, le toucher et l’odorat (oui, j’aime l’odeur des livres) s’ajoute à son intérêt intellectuel – ultime hommage indirect à un poète esthète et sensuel.
Les plus friands céderont ensuite à la tentation et s’offriront comme moi l’exquis catalogue publié pour l’occasion. Deux essais envisageant la place de l’amour et de la sexualité chez Victor Hugo ouvrent le volume, qui donnent également un bon aperçu du contexte (social, moral, artistique). Puis vient un florilège de beautés plastiques et de découvertes textuelles (extraits de textes hugoliens publiés du vivant de l’auteur mais également de carnets, lettres, œuvres posthumes, etc.). Le plaisir physique procuré par ce livre qui flatte l’œil, le toucher et l’odorat (oui, j’aime l’odeur des livres) s’ajoute à son intérêt intellectuel – ultime hommage indirect à un poète esthète et sensuel.