J’ai lu ce livre et le lendemain, je l’ai relu.
Sa puissance et son écriture m’ont enthousiasmée.
Évidemment, le sujet avait tout pour me plaire : une descendante d’un des rescapés du radeau de La Méduse écrit sur cet héritage particulier et ses effets sur sa famille et elle-même. Elle tisse pour ce faire une toile où se croisent les fils de l’histoire, de l’art, du devoir et du vécu. Ce que je ne pouvais en revanche deviner avant d’entamer ma lecture, c’est à quel point les réflexions et les émotions qu’elle dévoile au fil des mots entreraient en parfaite résonance avec moi.
Je n’ai pas la chance de porter un nom extraordinaire (Griffon du Bellay, n’est-ce pas divin ?), ni de connaître mes ancêtres, ni d’avoir hérité de quoi que ce soit, sur les plans matériel et historique. Je ne viens pas d’un milieu qu’on peut dire privilégié, mais prolétaire. Bref, sur le papier, l’univers de l’autrice et le mien sont fort éloignés. Pourtant, en lisant Ressacs, j’ai eu l’impression de rencontrer une âme sœur. C’était inattendu et troublant. Sans doute ne serai-je pas la seule à éprouver ce sentiment, par exemple en lisant ce passage, au début du livre [ce qui est en italique correspond à des écrits de jeunesse que Clarisse Griffon du Bellay insère dans son récit] :
C’est une chose tellement absurde d’être si jeune et de se sentir si proche de la mort, à en être déjà pétrifiée. Cette impression morbide a commencé à se graver en moi. Je me sens sur le fil. Instabilité générale. Et cette solitude.
J’ai descendu du grenier un carton entier contenant des cahiers et des carnets de croquis de tous formats. Les grands cahiers, qui voudraient être des journaux, ne sont toujours qu’entamés. Je n’ai jamais été régulière avec l’écriture. J’ai des envies soudaines, que je poursuis un moment. Lorsque je reprends, quelques mois ou quelques années plus tard, je commence un nouveau cahier, comme pour rompre, signifier un nouveau départ. Il manque tant de tournants.
J’aurais pu écrire chacun de ces mots.
Mais revenons à l’ouvrage, et à son titre, d’abord, dont on mesure au fil de la lecture à quel point il est parfait : il évoque à la fois la mer, bien sûr, lieu du drame primordial et lieu de hantise personnelle de l’autrice, mais aussi ces incessants mouvements de la mémoire familiale et autres ressassements de qui sonde le passé et sa propre psyché.
De ce texte profondément autobiographique, on perçoit d’emblée la sincérité. Les phrases sont souvent courtes, parfois non verbales, modernes en somme, et on remarque une manière singulière d’user de certains termes. Quelques expressions strictement contemporaines m’ont fait froncer le sourcil, notamment l’épouvantable « échanger » employé de manière intransitive pour dire « discuter, parler », que je ne m’attendais pas à trouver dans un texte d’une telle qualité (hélas, il est donc partout, malgré son caractère fautif !), mais dans l’ensemble, le style de l’autrice m’a séduite, tant il semble traduire un être réel, une personnalité.
Ressacs est également le récit d’une tragédie, celle vécue par Joseph Jean Baptiste Alexandre Griffon du Bellay, vingt-huit ans, qui se trouva, à la suite d’un concours de circonstances, au mauvais endroit au mauvais moment, à savoir sur La Méduse, puis, suite au naufrage, sur le radeau demeuré si tristement célèbre, ne serait-ce que par le tableau de Géricault. Il survécut, l’un des quinze sur les cent cinquante hommes initialement massés sur le radeau, et – voilà l’origine de notre livre – il prit soin d’annoter (pour lui-même ? pour ses descendants ? pour la postérité ?) le récit que deux autres survivants, Corréard et Savigny, publièrent, et dont il acquit un exemplaire de la seconde édition (1818). [L’édition de 1817 est accessible sur Gallica, si vous êtes curieux de découvrir ce récit.] Comme le rappelle l’autrice, le naufrage de la frégate fut plus qu’un simple fait divers à l’époque. Outre le nombre de morts, le choc de la révélation de l’anthropophagie, ce fut la source d’une polémique politique dont nous avons tout oublié aujourd’hui, mais qui devait peser sur les quelques survivants, en plus de leur traumatisme psychologique, largement tu. L’autrice rapporte, en plusieurs séquences entrelacées avec ses réflexions autobiographiques, le récit des événements tel que les historiens ont pu le reconstituer. Elle peint avec talent les massacres successifs organisés pour permettre la survie de quelques-uns (surprise, surprise : les personnes les plus importantes par le nom ou le statut ; oui, même dans une situation catastrophique et absolument anormale, les inégalités sociales perdurent), la transgression rationalisée du tabou de la consommation de chair humaine, dans un même but de survie. Elle dit aussi la folie suicidaire de ceux qui n’ont pu supporter la tension permanente, la peur, le désespoir. Sa façon de narrer et commenter avec justesse le sort des naufragés suffirait en soi à justifier la lecture de ce volume. C’est une épure de cauchemar, empathique, sans complaisance morbide. Dans une certaine double page, j’ai même cru percevoir, dans la disposition des phrases brèves, des blancs typographiques, des mouvements du texte, le tableau du radeau à demi submergé et des survivants tentant de résister aux vagues ! Impression très subjective, j’en conviens, mais qui m’a persuadée de l’excellence de la description.
Le livre annoté par l’ancêtre fut transmis de fils aîné en fils aîné (noblesse, quand tu nous tiens) et entouré d’un secret dont l’autrice analyse les ressorts – entre autres, la volonté de protéger le nom de la famille, la mémoire de l’aïeul, et de respecter la volonté du père, une génération après l’autre. C’est que, ces annotations n’étaient pas anodines ; le rescapé y disait ce qu’il avait fait et vécu. Corrigeait, en quelque sorte, le récit publié, fortement arrangé par ses auteurs. Ce secret de famille qui a commencé à être éventé par le grand-père de l’autrice achève de l’être par elle, à travers ses œuvres plastiques d’abord, et ce récit surtout. Pourquoi ? Parce que cette histoire, connue par bribes dès l’enfance, et le silence qui l’entoure ont eu des répercussions profondes sur Clarisse Griffon du Bellay. Elle explique combien sa démarche littéraire est en soi une tentative d’émancipation par rapport aux siens et de libération, porteuse de joie et de nécessité tout à la fois. Elle aborde aussi les effets de ses tentatives de révélation du secret familial, qui, par définition, ne lui appartient pas en propre, en particulier sur sa relation avec son père.
Cette analyse se combine à celle de la genèse de ses créations tant plastiques que littéraire (ce livre), nées, de toute évidence, de cette mémoire inscrite dans la chair et le sang malgré le non-dit omniprésent. On serait tentée ici d’invoquer le concept de transmission transgénérationnelle. Clarisse Griffon du Bellay est devenue sculptrice sur bois, et son travail semble répondre à une exigence cathartique, notamment quand, très jeune, elle réalise son radeau. L’épreuve physique et mentale que représenta ce moment créatif est exprimée de façon poignante et touche en plein cœur – en pleine viande, pour reprendre un mot très présent dans cette partie du livre. L’art apparaît comme l’exutoire, la solution vitale pour tenter de vaincre les angoisses, cauchemars et autres blocages.
L’autrice prête à son aïeul ce même sentiment de nécessité impérieuse, comme pour mieux nouer un lien avec lui :
On ne sait rien de sa vie intérieure. Ce qu’on sait c’est ce geste d’écrire. Cette nécessité d’écrire.
Tout est dans ce livre.
Et dans le fait de l’avoir laissé.
On peut penser ici aux écrits de l’extrême, à tous les témoignages laissés par ceux qui se trouvaient dans des conditions telles que l’écrit ou le dessin devenaient un moyen de survie mentale. L’autrice écrit encore :
Je l’imagine écrire dans une solitude fondamentale.
Les marges offrent un refuge hors du monde, hors du temps, à sa parole empêchée.
Empêchée par l’époque.
Empêchée par lui-même.
Par la probable certitude de ne pouvoir partager cela avec aucun être humain.
Inscrire quelque part le plus inavouable.
Le récit se clôt sur l’achèvement de sa propre rédaction. Un livre pour un autre… La boucle pourrait sembler bouclée. Elle ne l’est pas vraiment, mais le sentiment d’avoir accompli quelque chose est là, indéniable, concrétisé dans le livre :
Les mots se sont déposés partout.
Ils sont entrés en résonance, révélant la trame qui me constitue. Je peux désormais libérer de moi le son de mon ancêtre. Restituer à l’histoire collective ce que j’ai toujours pensé lui devoir.
Je contemple ce livre comme une sculpture qui se termine.
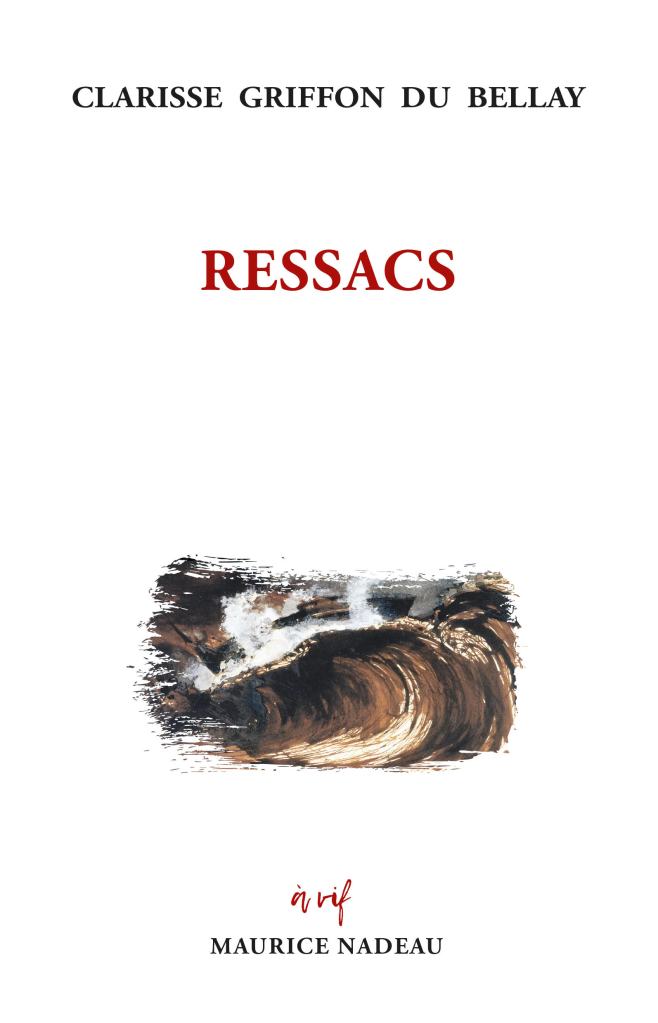
Il faudra que je le lise un de ces jours.
Oui, même si ce n’est pas forcément ton type d’écriture. Il me semble que, dans son genre, c’est vraiment une réussite.
Bonjour Virginie, Un grand merci pour cette belle analyse en profondeur de l’oeuvre de Clarisse GdB qui pointe au plus juste son moteur d’écriture, avec les citations appropriées ! Très cordialement, Laure
Éditions Maurice Nadeau – Les Lettres nouvelles 5 rue Malebranche, 75005 Paris +33 1 46 34 30 42
https://www.maurice-nadeau.net/index.php https://twitter.com/Ed_M_Nadeau https://www.instagram.com/edmauricenadeau/ https://www.youtube.com/channel/UCa0qhIM8ZydjNXXb7y6VyZQ
>
Chère Laure, merci aux éditions Nadeau de publier ce genre de texte !
Pingback: Ressacs – Ma collection de livres