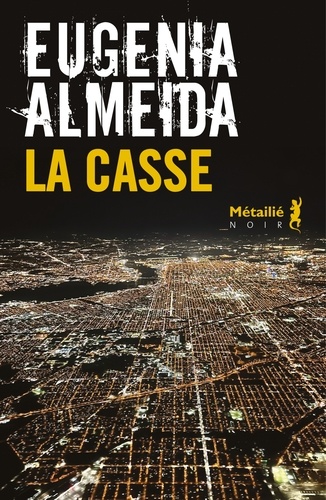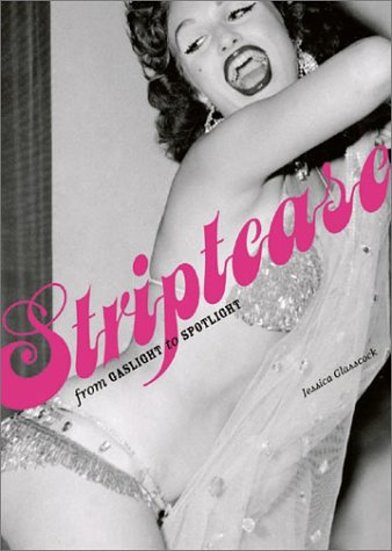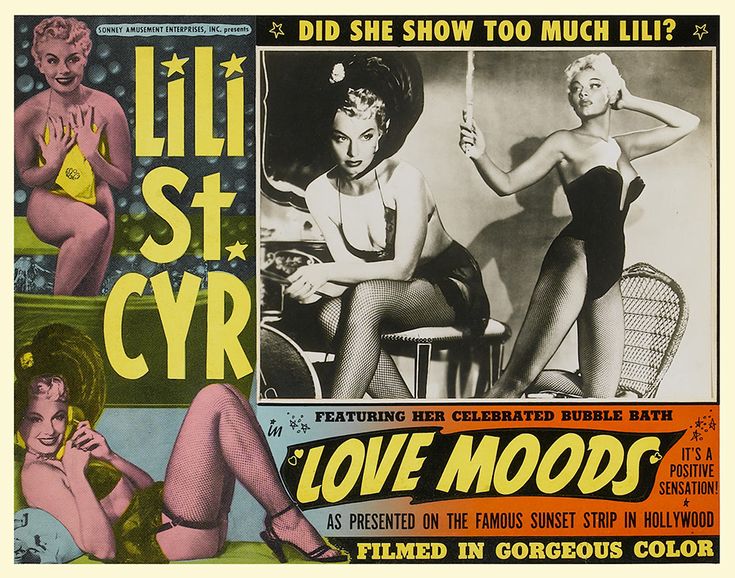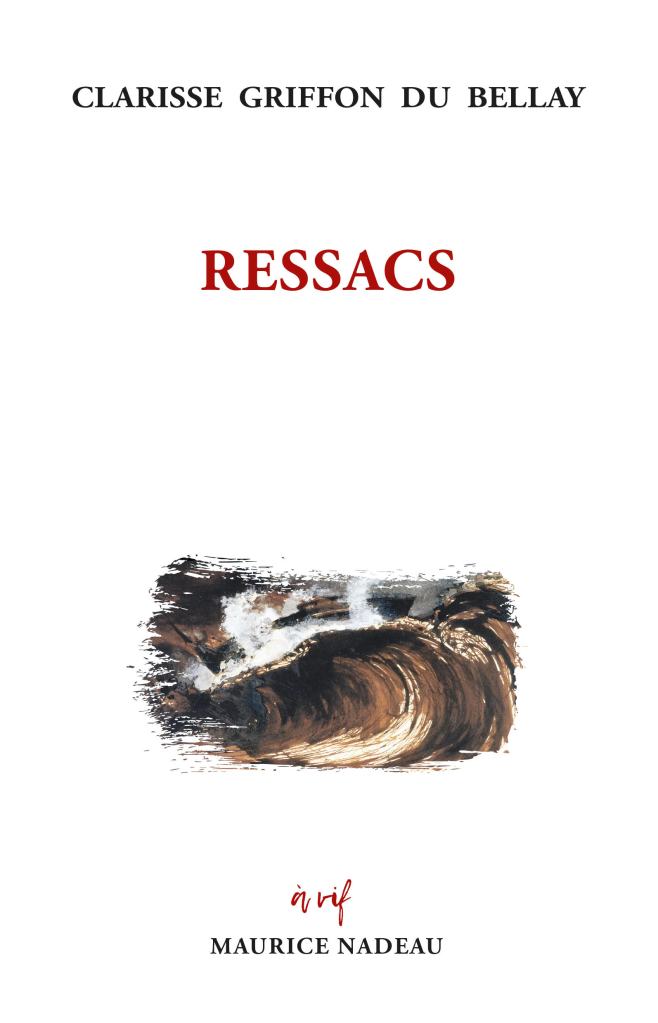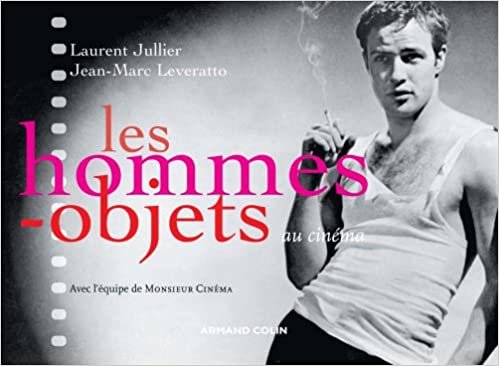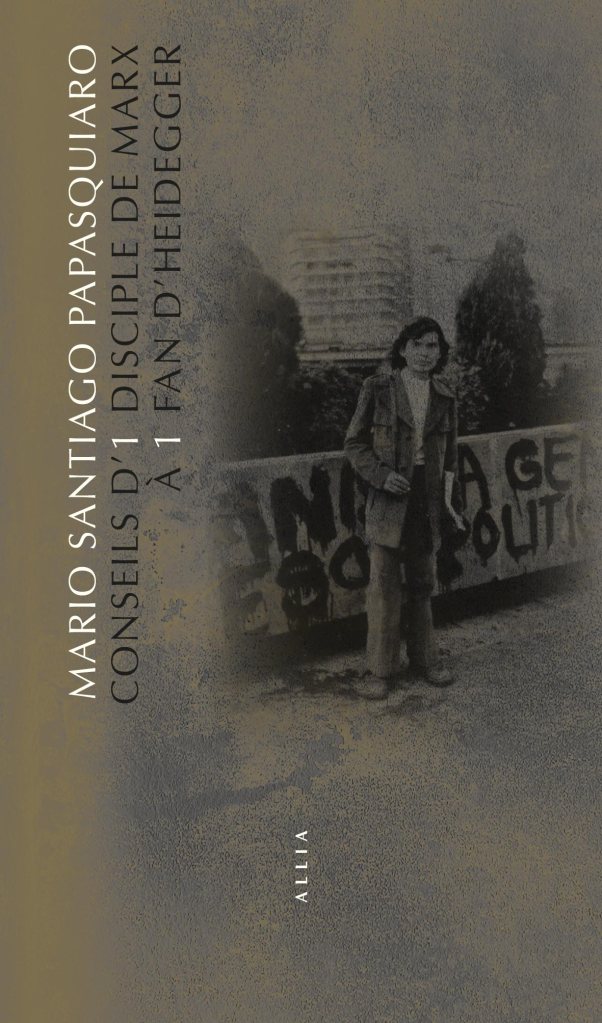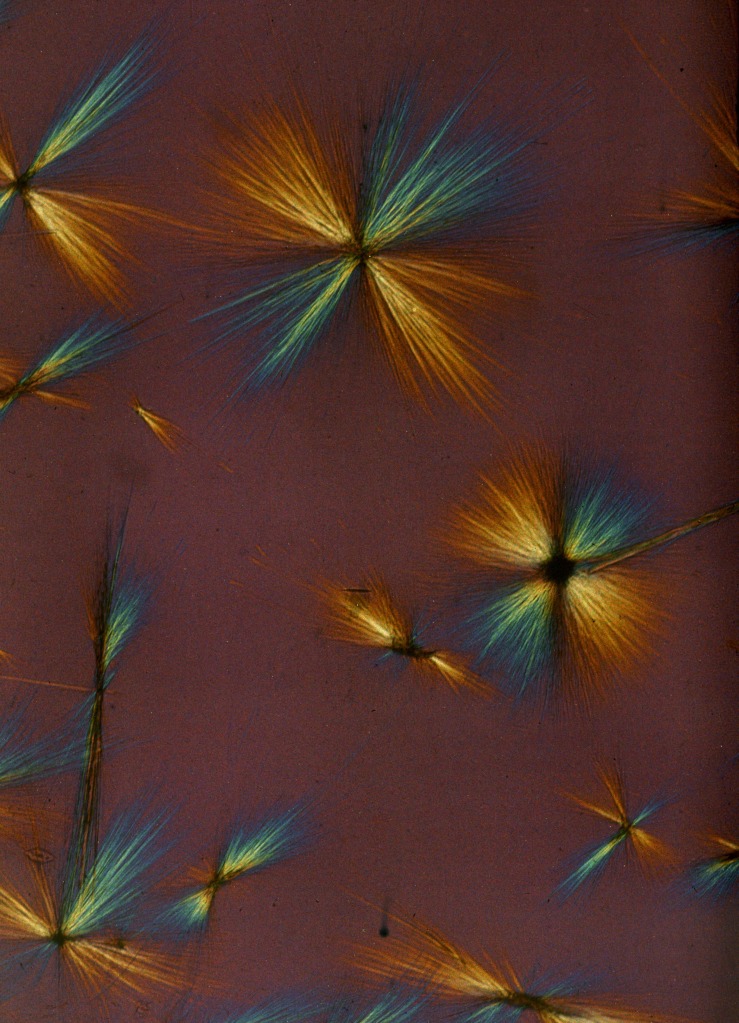Lydie Salvayre adore les satiristes classiques et cela se sent plus que jamais dans l’essai récemment paru. Si l’on commence sa lecture par un texte empreint de lyrisme, où s’évoque en douceur l’enfance – époque bénie où l’on échappait encore au travail et à l’injonction de productivité –, on bascule assez vite dans une sorte de réquisitoire enlevé contre une certaine idéologie contemporaine de la « valeur travail », selon l’expression reprise à bouche que veux-tu par le personnel politique, et hélas devenue la doxa de nos sociétés occidentales, le bourrage de crâne fonctionnant à merveille. On flirte avec le pamphlet et sa langue vigoureuse, par exemple, p. 28 :
Alors, ces dépouilleurs de pauvres, ces cleptocrates, ces spoliateurs qui ont pognon sur rue (Salvayre) et que dans notre jeunesse nous qualifiions de porcs, de requins, d’enflures ou de raclures de bidet, ces apologistes-du-travail-des-autres s’emploient avec une détermination rare à nous convaincre des immensissimes bienfaits du travail, en exhibant des chiffres vérifiés par l’Institut international de sciences économiques, et faisant déverser sur nos têtes les laïus de leurs experts sagacissimes, éminentissimes et extrêmement télévisuels, dont la seule fonction est d’injecter leurs menteries dans nos cervelles sans défense.
Cette attaque en règle s’accompagne d’une apologie énergique de la paresse, que l’autrice ou plutôt le narrateur à la première personne du pluriel prend soin de définir à plusieurs reprises (par ce qu’elle n’est pas – la paresse défaut-péché brandie par certains comme un épouvantail – et par ce qu’elle est – une forme de présence au monde, à soi-même, de sagesse, de courtoisie, etc.). Soit dit en passant : qu’il est agréable de lire des gens qui savent de quoi ils parlent, conçoivent clairement les choses et emploient sûrement les mots, à l’inverse de nombre de journalistes, figures politiques, et de la majorité de la population, qui semblent se complaire dans la reprise de termes et concepts aux contours indéfinis, auxquels ils ne prennent pas la peine de songer avant que de les employer.
Reprenons.
Dans sa langue savoureuse qui mêle joyeusement les registres et les tons, Lydie Salvayre peint le tableau de notre société égarée dans les fausses valeurs et vraies plaies promues par une élite soucieuse d’accroître ses privilèges en exploitant le bétail humain. Bétail, outil, consommateur, c’est en effet ce que nous sommes devenus, dans un système qui prétend que le travail est une exigence morale, économique et sociale, une nécessité absolue, et méprise la liberté de penser, d’être soi, et de cultiver son jardin, son esprit, son corps – son humanité. Travailler plus pour gagner plus pour consommer plus pour enrichir plus les nantis. Et se retrouver épuisé, incapable de faire quoi que ce soit de vraiment important pour son être profond, aigri, déprimé, abêti et usé.
Démontant brillamment le discours propagé depuis deux siècles (disons : depuis le début de la révolution industrielle) comme un virus par les tenants du pouvoir économique et politique, et quelques penseurs dont on aurait souhaité qu’ils meurent en jeune âge de quelque maladie plutôt que d’émettre leurs théories assassines (c’est moi qui parle, pas l’autrice), Lydie Salvayre ouvre grand les portes d’une réflexion politique au sens étymologique et humaniste, convoquant à ses côtés des poètes et écrivains, comme Rimbaud, Baudelaire, Lafargue (évidemment !) ou encore Rabelais, à qui elle laisse le mot de la fin ; des philosophes, comme Fourier et Nietzsche ; des théoriciens et hommes politiques comme Blanqui ; des touche-à-tout comme Bertrand Russell ou l’inimitable Guy Debord, et tant d’autres ! Ils forment un réseau dense et séculaire de champions contre l’asservissement (moral, physique, intellectuel, social…) de l’homme et pour la prise en compte de sa liberté fondamentale et de son droit d’exister, vraiment, pleinement. Ils paraissent faire partie de ce « nous » que l’autrice emploie tout au long du texte, non pas un nous de majesté, ni de modestie, mais un nous généreux, distinct de Lydie Salvayre (qui d’ailleurs fait irruption dans le texte comme si elle était une voix extérieure venant parfois mettre son grain de sel dans le propos), invitant tous ceux qui partagent sa vision du monde et de l’humanité, et emporte, et soulève, un « nous » qui tantôt se fait bretteur, tantôt libelliste, tantôt taquin, joueur, moqueur. L’énergie qui infuse l’intégralité du propos se déploie contre un « vous » représentant ceux que l’autrice appelle les « apologistes-du-travail-des-autres », lesquels ne manquent pas de s’en prendre plein les dents, et parfois dans une langue verte et fleurie des plus réjouissantes (on admirera la capacité de Lydie Salvayre à donner l’impression de la spontanéité, du coup de sang, de l’indignation).
Finalement, en parfaite cohérence avec cet essai plein d’espoir et sans doute utopiste – mais, comme l’autrice l’écrit (p. 79), n’en déplaise aux grands patrons, gouvernants et autres économistes arc-boutés sur leurs certitudes délétères et leurs acquis, l’utopisme n’est pas un défaut ou un gros mot, non, c’est une formidable occasion de rêver l’avenir et, parfois, d’ouvrir une nouvelle voie –, le « nous » qui s’exprime dans ces pages offre une sorte de programme révolutionnaire (mais pacifiste et doux) qu’on pourrait dire d’insoumission et de rébellion socio-professionnelles. On notera l’usage optimiste du futur, non du conditionnel, et du présent dans ce manifeste dont l’autrice désamorce le sérieux par moult saillies drolatiques et une bonne dose d’autodérision. Carpe diem ! en somme, non d’une manière égoïste propre, précisément, au modèle capitaliste libéral, mais en philosophe éclairé et se connaissant soi-même. Le texte nous invite à repenser nos vies souvent misérables car aliénées, à nous libérer de la (sur)consommation presque imposée depuis deux ou trois décennies à nos pauvres esprits dès l’enfance, et à retrouver le plaisir vrai et vital de réfléchir, rêver, muser, d’être dans notre corps aussi, un corps qui ne devrait pas être perpétuellement épuisé, et de lire, lire, et encore lire, pour renouer avec l’infini champ des possibles qu’offre cette activité. Parmi de nombreuses citations que j’aurais pu faire ici, en voici une (p. 19-20) :
Nous aimons arracher ce mouchoir de dégoût que le travail contraint nous enfonce dans la bouche,
et nous délester des corsets qui nous enserrent et nous étouffent mais auxquels nous nous croyons stupidement soumis,
Nous aimons avoir au cœur la joie de se délier, de se déconnecter, de se désencombrer, de se déprogrammer, de se désaveugler, de se désharnacher, de se désentraver des liens que l’on maintient par lâcheté, par habitude ou par veulerie,
puis, grâce à cette décoïncidence, trouver justement la meilleure adéquation entre soi et soi, et une meilleure appréhension du monde.
Autant de choses qui s’apprennent,
autant de choses à oser,
et qui demandent juste une once de courage.Car vous l’avez compris, dans la situation actuelle, paresser c’est désobéir […]
Commencez donc par lire cet essai et, comme moi, voyez s’il ne vous incite pas, alors que vous hésitiez encore, à changer d’existence et à devenir des anarchistes tranquilles mais obstinés, qui refusent de continuer à vivre en zombie, les yeux et le cœur fermés, le corps mort, et l’âme confisquée.